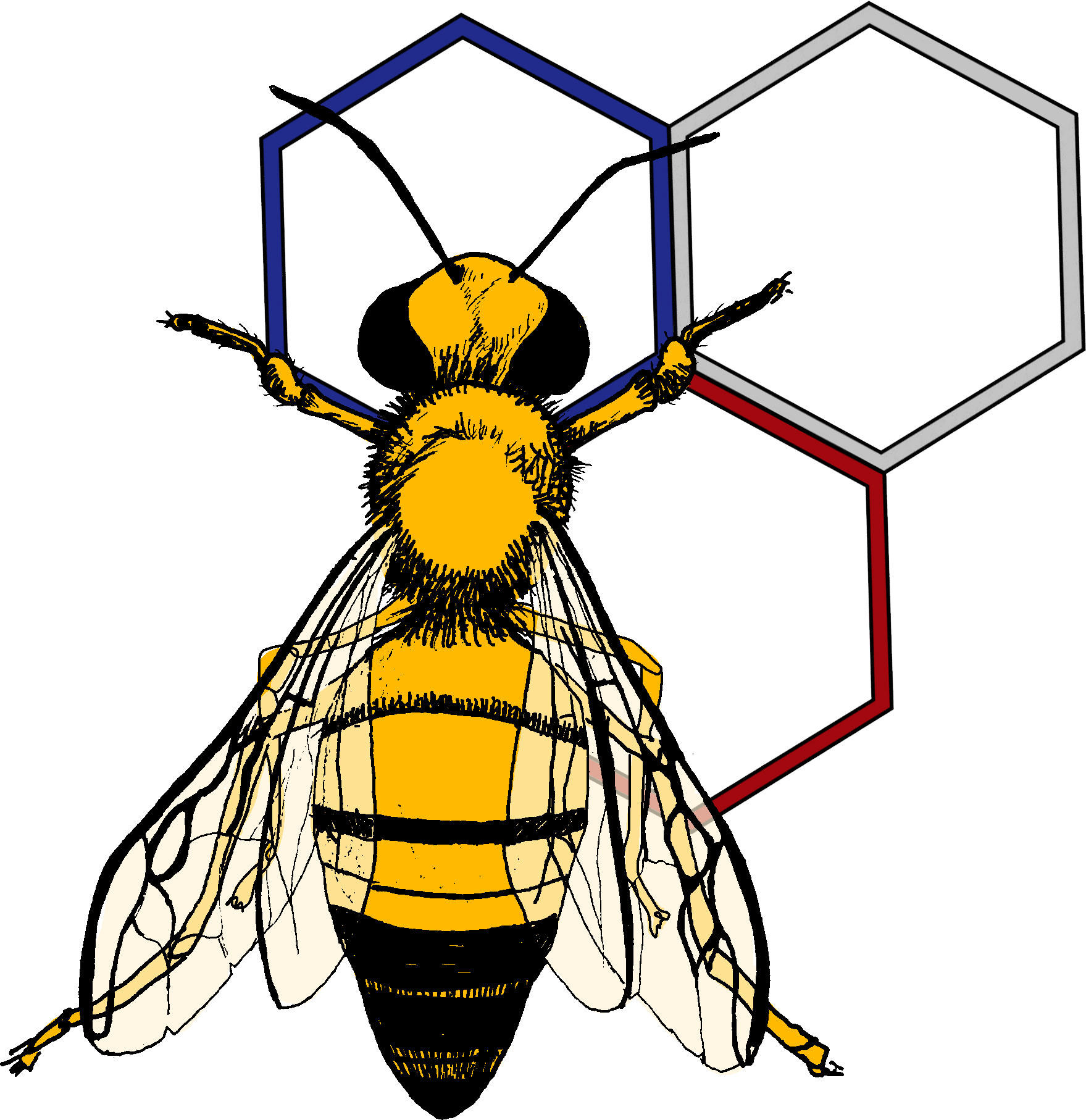Depardieu | LE DIABLE ET LE GÉNIE
Tentative d’intelligence d’un fait divers
Premier point. Depardieu est un génie. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est accusé de viol. Son affaire, l’affaire Arnould, n’implique ni violence, ni menace, ni contrainte physique, ni surprise.
Seule une contrainte morale est invoquée par les magistrats, fondée sur une double affirmation : Depardieu est un monstre sacré ; et Mme. Arnould, qui le connaissait depuis enfant, voulant devenir actrice et était malade, ne pouvait lui résister.
C’est parce qu’il est un génie et qu’il avait sur elle une forme d’emprise qu’elle aurait concédé à deux reprises, à un acte sexuel avec lui.
Il est donc ridicule de critiquer ceux qui se sont pris de défendre M. Depardieu en rappelant ce fait : Depardieu est un génie. C’est le point de départ de son affaire.
C’est la reconnaissance par la justice de cette qualité qui lui vaut d’être poursuivi.
Deuxième point. L’affaire Depardieu n’existe dans l’espace public que du fait de la défaillance de l’appareil judiciaire français.
Cinq ans et demi après les faits, les magistrats n’ont toujours pas été capables de décider si un procès devait ou non se tenir contre M. Depardieu.
Cinq ans et demi passés par la justice à s’interroger sur la nécessité ou non de tenir un procès.
Ce n’est pas long. C’est interminable et scandaleux. Car ce sont cinq ans et demi qui suspendent la vie de tous les participants à la procédure, les figent, et pour certains, en dévastent les jours et les nuits.
Ces cinq ans et demi sont également une catastrophe pour la lutte contre les violences sexuelles.
Car à force de ne pas être résolue, et parce qu’il s’agit d’un personnage public, et parce que l’affaire a été médiatisée, la société finit par s’en saisir, et par vouloir agir là où la justice a failli.
Trancher.
Rien n’explique ces délais. Les faits sont reconnus. La procédure porte sur deux événements matériellement attestés, sur lesquels aucune enquête n’a à être menée, puisqu’aucun témoin n’était présent et qu’aucune trace matérielle supplémentaire ne saurait être retrouvée.
En somme, une fois la parole de chacun recueillie, les expertises – toute une histoire, les expertises… – faites, il faut juger, ou décider qu’il n’y a rien à juger.
L’absence de moyens, mal chronique de la justice française, n’est en rien responsable de cette durée. Il en va de même du comportement des parties, à pleine disposition de l’appareil judiciaire.
Pourquoi donc cette affaire si simple s’éternise, et mobilise des énergies, du temps, là où elle aurait dû être réglée ?
Hypothèse : la lâcheté. Les magistrats sont pris en étau entre le monstre sacré, la peur de le renvoyer – et la crainte à l’inverse que la société interprète un non-lieu, qu’elles qu’en soient les raisons, comme la preuve d’une insupportable impunité.
Ce dysfonctionnement contamine la société.
Il amène à ce qu’un Président de la République se saisisse d’une affaire individuelle. À ce que, sans pudeur, des milliers de citoyens, des associations, journalistes, intellectuels, donnent leur avis sur une affaire pénale censée être couverte par le secret.
Scrutent, observent, s’interrogent sur des paroles, des gestes, des corps. Des pensées.
Se substituent aux juges censés trancher.
Sans que rien ni personne ne puisse décider.
Et voilà des vies et des intimités prises, saisies entre les regards et les paroles, qui se prennent de les décortiquer, pour une durée indéterminée.
Dévastateur. Pour les parties. Pour la personne ainsi visée. Pour la lutte contre les violences sexuelles. Pour tous ceux qui attachent une quelconque valeur à la notion de dignité.
Troisième point.
M. Depardieu n’est pas devenu sacré, connu, puissant – qu’importe – parce qu’il était bien né.
M. Depardieu est né dans ce que les biens-nés considèrent être la fange de la société.
On rappelle à juste titre qu’il aurait affirmé, jeune, avoir participé à de nombreux viols, puisque, dit-il, c’était alors et là-bas « normal ». Notons cette double affirmation : en un temps et un lieu qui n’était pas celui de ses interlocuteurs, un autre rapport au monde et à l’Autre s’imposait.
Comme le raconte Saint-Augustin, Depardieu serait « allé aux abîmes », et l’on trouvera une similitude frappante entre leurs deux témoignages, à quelques siècles près. « J’allais aux abîmes, à ce point aveuglé qu’au milieu de jeunes gens de mon âge, j’avais honte de leur être inférieur en turpitude. Je les entendais se vanter de leurs dévergondages et se glorifier à proportion de leur infamie, et je me plaisais à faire le mal, non seulement par sensualité, mais aussi par vanité.
Qu’est-ce qui mérite d’être décrié si ce n’est le vice ? Et pourtant, pour ne pas être décrié, je me faisais vicieux, et quand je ne pouvais m’égaler aux pires par une mauvaise action, je feignais d’avoir commis ce que je n’avais pas commis ».
Depardieu semble singer Augustin, qui prétendit, en Cicéron, comme Depardieu le ferait en Musset, avoir trouvé ce qui « changerait en lui ses sentiments » pour s’extirper de ce mal qui partout affleurait.
On rappelle moins que de la même façon qu’il aurait affirmé avoir participé à des viols, M. Depardieu dit avoir été violé, à de nombreuses reprises, puisqu’il a été prostitué, dès l’enfance, avant d’être payé pour protéger des prostituées. Qu’il décrit cette fréquentation, protectrice, comme l’une des plus précieuses de sa vie.
Qu’en penser, alors, de l’homme et de son passé, lorsque tous les versants sont reflétés ? Victime ou prédateur ? Victime et prédateur ? Qu’en déduire, sans se brouiller ?
Hypothèse : M. Depardieu est né dans la violence, et a tenté de s’en extirper, par l’art et la création, une sensibilité que personne ne peut sérieusement nier.
Jusqu’à devenir sacré. Jusqu’à se montrer en capacité d’en parler. Jusqu’à éventuellement, pouvoir en abuser.
C’est pour cela qu’il en parle. Comme pour l’exorciser.
C’est pour cela qu’il joue. Qu’il s’est plongé dans la littérature.
Jusqu’à l’épouser, déployant ce que l’on dit un immense et vorace talent : un génie. Qui n’est qu’une projection, une inversion de toute la saleté de l’humanité, générée par notre société, en un espace, sublimé, celui du théâtre et du cinéma, de la représentation, censé prévenir la répétition traumatique, tant pour ceux qui y participent que pour ceux qui vont y assister.
Ce talent, et cette sensibilité, seraient ce qui explique qu’il y en ait tant pour le défendre.
Que l’on cherche même quelque part à lui offrir une impunité
Pour qu’il puisse l’approcher, cette saleté. La subvertir, puis la dépasser.
Peut-être également est-ce le succès, qui en a tant fascinés, et dont on peut parfaitement supputer qu’il ait eu un double effet : qu’il ait amené, d’un côté, M. Depardieu à se montrer délicieux et prévenant avec ceux qu’il admirait, et détestable et empiétant avec ceux qui venaient des mondes qui l’avaient enfanté.
Ambivalence qui explique peut-être la gêne qui a saisi à la vision des images de Complément d’enquête – recherchant le spectaculaire et le scandaleux, plutôt qu’une quelconque forme de pensée.
En ce Complément d’enquête, putassier, on voit en effet un homme qui soudain, par son occupation de l’espace, en un pays étranger, un pays dictatorial, s’impose physiquement dans celui de sa traductrice, qui sait qu’elle ne peut se planter, que la moindre friction avec son prestigieux invité 4 pourrait emporter ses destinées, puisqu’il est un invité d’État et qu’en quelques sortes, il bénéficie à ce titre d’une forme d’impunité.
Depardieu, qui le sait, décide d’en jouer. Et d’en abuser.
Il y mime, ou y adopte, le comportement habituel de ce que la doxa considère être les prédateurs, incapables de respecter l’espace de l’autre, prenant plaisir à y pénétrer.
La blague vaseuse sur la jeune enfant qui fait de l’équitation, en un pays où personne ne comprend ses propos, est équivalente à celle qu’il fait sur les gaz au début de ce reportage, et en cela, rien à côté de ce geste, de l’occupation de l’espace déplacée qu’il va mettre en œuvre aux côtés d’une accompagnatrice tétanisée. M. Depardieu, lorsqu’il prononce ces propos sinistres, ne le fait pas pour que ce soit rapporté, mais pour impressionner, heurter, amuser ceux qui sont à ses côtés. Il sait l’objet de sa « blague », cet enfant, incapable de le comprendre, et cela le renforce dans la volonté de pénétrer cet espace pour le déformer. De transgresser.
Il fait comme tant de touristes à l’étranger, jouissant de ce sentiment d’incompréhension qui leur est offert par le mur de la langue, et leur permet de raconter n’importe quoi à un être en chair et en os qui leur fait face, profitant de cette merveilleuse impunité qui leur permet à la fois de ne pas les heurter et de ne pas être sanctionner. Il pousse ce rapport à l’extrême.
Il est normal, revenu dans un univers linguistique partagé, de le condamner. On ne rit pas de ces choses-là. On ne touche pas à ces choses-là. Mais il est intelligent aussi de le contextualiser, et de comprendre que ce n’est pas ce geste-là qui doit nous inquiéter.
Mais plutôt celui commis, auprès de cette traductrice, soudain arrinconada, cornérisée – il est intéressant que la langue française n’ait pas véritablement de mots pour traduire ce geste d’encerclement de l’autre, assiégée dans un coin – et ce visage qui soudain, quelques plans plus loin, se ferme, après une autre « blague », sur une terrasse.
Ce visage qui terrasse, soudain.
Cette dureté.
Voilà pour la nouvelle facette. Celle que l’on a décidé, soudain, à la lumière d’une accusation de viol, de révéler. Car M. Depardieu, jusqu’ici, a été dans l’espace public l’être qui parlant de lui ou d’autres, se montrait capable de le faire avec une intense douceur et sensibilité, dénuée de la moindre ambigüité, à fleur de peau et semble-t-il impossible de qui que ce soit blesser.
Cela nous amène à la question que tous, naturellement, ont envie de se poser.
M. Depardieu est-il un violeur ? Voilà la question à laquelle tous semblent enjoints de répondre, mais il y a comme un malaise, une gêne, à se la voir posée – ce qui explique que tant aient le réflexe de renvoyer à la justice, pour esquiver, comme si celle-ci n’était pas composée d’hommes et de femmes tout aussi incapables que nous, quels que fussent leurs instruments, de se prononcer sur la vérité d’un être, ainsi réclamée.
Il convient donc peut-être, avant de se précipiter, de s’interroger sur cette recherche d’essentialisation qui nuit tant à la victime qu’au mis en cause, avant même de s’interroger sur l’indécence consistant à porter dans l’espace public un tel débat sur une affaire de cet ordre-là, 5 sur un être quelconque, mis à nu et décortiqué dans son intimité, au nom d’on ne sait quoi – un ordre public, certes, mais également et plus probablement, un voyeurisme né d’une insondable curiosité, d’une curiosité née de l’insondabilité.
Car la véritable question est la suivante : faut-il être violeur pour violer ? Et le violeur l’est-il systématiquement, par nécessité ? Non. C’est absurde. Et c’est ce qui devrait inquiéter. La théorie du « continuum » qui habite certaines pensées féministes et a tant nourri les différentes procédures récentes semble mal placée, et ne pas interroger son sujet.
Non, pour une raison très simple : nul besoin « d’être violeur » pour violer. Nul « violeur » – outre cas extrêmes et psychopathologiques – qui systématiquement, l’est.
Alors, pourquoi cette question qui lancinante, nous est posée ?
Il apparaît d’autant plus important de l’interroger, cette question, que l’extension de la définition du crime de viol est devenue telle que toute friction dans le rapport au consentement semble désormais pouvoir l’englober.
Pourquoi donc, alors que l’on ne cherche pas à savoir, pour condamner ou non quelqu’un qui a volé, s’il est ontologiquement voleur, pourquoi donc faudrait-il savoir, pour savoir si une infraction de viol a été commise ou non, si l’être qui l’a commise est violeur, transformant les procédures judiciaires, et des magistrats censés être saisis in rem, en des inquisiteurs se croyant saisis in personam, fouillant jusqu’aux tréfonds de la personnalité et du passé des personnes concernées, cherchant à absolument les diaboliser ou les sanctifier ?
Pourquoi donc ce qui apparaît nécessairement comme une dérive qui menace les fondements mêmes de notre droit, et nous expose à dépasser toutes les limites, à les violer ?
Une réponse peut être apportée.
Parce que l’on a fait du viol ce qui fixe la limite de l’humanité. N’est pas humain celui qui s’impose à l’autre dans son intimité. Or l’appartenance au genre humain est un invariable. On en est ou on n’en est pas. Celui qui une fois transgresse transgressera toutes les fois.
Ce déplacement de l’objet de nos questionnements, de l’objet au sujet, du geste à l’être, explique d’ailleurs paradoxalement que se soit formée autour de cette infraction une telle impunité.
C’est parce que l’on a fait du crime de viol un absolu, dont les conséquences en cas de condamnation dépassent largement l’espace judiciaire – entraînant une éradication définitive, totale, une mort sociale persistant bien au-delà de la peine infligée – que l’essence de l’être qui le commettrait est devenue, plutôt que le geste, notre sujet.
On sait qu’en condamnant un être pour ce crime, on le condamnera tout entier, sans possibilité pour lui de se voir rédimer. Et la question qui se pose devient naturellement : sommes-nous prêts à condamner cet homme, bien plus que le geste qu’il aurait généré ? D’où s’ensuit une relativisation paradoxale, au moment même où l’on porte au pinacle l’importance attribuée au sujet.
La situation s’est, là encore paradoxalement, aggravée ces dernières années. Le viol, tel qu’il est défini aujourd’hui, est devenu une infraction sans traces. De la définition traditionnelle, qui le rattache étymologiquement à la violence, il est devenu un intangible, présence-omniprésence qui à tout instant peut être alléguée.
Et par conséquent le viol est paradoxalement devenu un improuvable. Parole contre parole. Pas de preuves. Il faut deviner, s’immiscer dans un espace qui, pour être défini comme intime, exige justement d’écarter tout regard extérieur, enquêter sur les personnalités de l’un et de l’autre – plus souvent de l’un, le mis en cause, que de l’autre – pour se décider. Encercler.
Dans le même temps, le déséquilibre, lui, s’est aggravé. Si pour la véritable victime, il est toujours aussi difficile, incertain, et potentiellement dévastateur – quelque part, donc, absurde – de se confronter à son bourreau à travers l’appareil judiciaire pour tenter de se réparer ; les choses ont été facilitées pour la fausse victime, qui se sait désormais renforcée par la présomption de véridicité offerte à sa parole ; disposer d’une parfaite impunité, et même, en un retournement du stigmate dont on mesure mal la portée, y trouver à se voir valorisée. Là où la procédure judiciaire est traumatique pour la victime et le mis en cause, elle propose un jeu de rôles agréable et confortable pour celui ou celle qui singerait et mentirait.
La fausse accusation rend en effet sans pesanteur et protectrices les milles étapes formalisantes, ahurissante de lourdeur et d’artificialité, que propose la procédure judiciaire. De facto sans conséquences, elle est une arme de destruction massive contre celui ou celle qui s’en verrait visé, que l’on peut s’offrir à peu de frais. L’honneur en nos sociétés étant une valeur effondrée, il ne faut se surprendre que cette arme soit toujours plus mobilisée.
Parole contre parole, donc, mais contrairement à ce que l’on croit, désormais largement au détriment de l’accusé, en particulier celui étant socialement exposé, qui, accusé, se verra dans l’espace public préventivement condamné, en une présomption entâchante dont il ne se défera jamais tout à fait ; et dans l’espace privé, durablement atteint, si ce n’est dévasté.
Parole contre parole, donc, en un processus qui, par effets accumulatifs, menace la société. Rappelons que contrairement à ce qu’affirment certains militants, le taux d’acquittement aux assises en cas de poursuites pour violences sexuelles est de 4,6%. Qu’en notre système, donc, ce n’est pas l’impunité qui est consacrée mais au contraire la culpabilité qui, pour quiconque se trouve pris dans les rets du judiciaire, est présumée.
Qui est renvoyé, en France, renvoyé en procès est, avant même d’être entendu, condamné.
Parole contre parole, donc. Avec cette conséquence : concernant cette infraction sans trace, se construit un dispositif judiciaire par lequel, trop souvent, seul l’aveu permettrait d’établir définitivement le fait.
Or l’aveu exige l’humanité. Et le violeur, par définition, nie l’humanité, celle de l’autre et par ricochet la sienne. Il sait par ailleurs qu’il sera mis définitivement au ban de l’humanité s’il avouait. Le violeur, s’il l’est ontologiquement, est donc celui qui, dans l’incapacité d’élaborer, ne saura se reconnaître comme l’étant. Et s’il l’a été ponctuellement, il est celui qui sait qu’il devra, pour subsister, absolument nier l’avoir été, puisqu’autrement, au violeur ontologique il se verra renvoyé.
Nous voilà pris dans le piège. En une circonstance comme une autre, l’aveu est impossibilité par l’absolutisation du crime. On ne peut donc pas se reposer sur ce qui fonde pourtant le fonctionnement de notre justice, construite depuis un millénaire sur cette aspiration et cette idéalité : celle de faire avouer.
La boucle se referme. Car que faire, faute d’aveu ? Eh bien, encercler. Pour prouver ce qui ne peut pas l’être, l’on s’en remet à une tentative de caractérisation de l’être, de l’auteur de l’infraction, plutôt que de l’infraction elle-même. On l’interroge, le sonde, on cherche à savoir qui il est. Est-il un violeur – et donc – a-t-il violé ? La victime est-elle une menteuse, une opportuniste, une prostituée, et donc a-t-elle fabulé ?
Cette inversion est dangereuse, parce qu’elle nous fait revenir à l’inquisition, à cette idée que c’est l’être qui serait à sonder, interroger, puis éliminer, et non le geste à établir puis sanctionner. Elle repose sur l’illusion, sur laquelle la civilisation était heureusement revenue, qu’il y aurait une vérité de l’âme, et que sur l’âme, l’institution judiciaire pourrait dire une vérité.
Le problème est que ce n’est pas vrai. Que l’institution judiciaire, profondément défaillante et plus profondément encore aveugle, a déjà souvent bien du mal à déterminer les faits. Alors, l’être…
L’être qui n’est par ailleurs pas univocité.
M. Depardieu peut à la fois être un homme à la parfaite sensibilité, et capable d’arrinconar une femme qui, en position de subordination, se retrouvera sans droit à lui résister.
Il y va, il pousse, mais, rappelons-le dans cet épisode, pour dégoûtant, répugnant, inquiétant qu’il soit : il s’en tient là.
Il n’a pas, là, violé. Qui sommes-nous pour dire qui il est, et par conséquent, qu’en d’autres circonstances, il l’aurait fait ?
Mme. Arnould se dit violée parce qu’elle n’aurait pu consentir, pas parce qu’elle y aurait été objectivement forcée. Parce qu’elle était trop fascinée. Trop exposée. Parce que M. Depardieu était un génie, un monstre sacré, et un homme avec lequel elle entretenait, elle, femme fragile et cherchant des voies pour se construire, depuis l’enfance, une trop grande proximité pour pouvoir ne serait-ce que penser à s’y opposer.
Elle s’est dite sidérée.
On pourrait, elle aussi, la juger. Entrer dans l’indécence. Dire qu’elle-même semble avoir ses ambigüités. La nécessité d’exposer dans l’espace public son « traumatisme », de se rendre visible, de se voir filmée, pourrait être décryptée, et dénoncée dans son ambivalence. Elle dont le devenir est, comme celui du mis en cause, suspendu à une procédure judiciaire qui depuis cinq ans les fait tous lambiner, que connait-on de ses véritables ressorts ? Comment les explorer ? Et comment en juger ?
Le même réflexe de pudeur qui retient le jugement devrait s’appliquer tant à elle qu’à M. Depardieu, sans que cela ne vaille blanc-seing, sans que cela ne soit indécent.
Non parce qu’il ne nous appartient pas de juger. Mais parce que l’on doit juger des faits. Et non des êtres.
J’ai entendu certains spéculer sur Mme. Arnould, et considérer que tout cela n’aurait été, de façon moins avouable, qu’une façon de compenser ses échecs, de se venger, ou même d’utiliser, elle l’apprentie actrice, un puissant qu’elle percevait comme détenant les clefs de sa vie, et qui les lui aurait refusées.
Voyez la pente glissante, et les difficultés aporétiques où l’on nous a placés.
Elles sont insupportables, ces spéculations. Parce qu’il est insupportable de creuser ainsi l’âme de l’autre, la grignoter et l’éroder, dans l’espace public ou privé, sans avoir eu à la connaître ou à la fréquenter. Car, comme nous, faute des faits, il est insupportable que la justice, dans la froideur de ses commissariats et de ses cabinets, cette justice emplie de préjugés et dénuée de moyens, se croit en mesure, avec à l’aide de quelques experts, de les arrêter et les juger, et prenne le risque de l’erreur, du mauvais condamné.
Dernier point. Si l’on revient à M. Depardieu, et à cette notion de contrainte morale, une question doit être posée : comment rendre coupable un être de ses qualités ? Lui qui n’est initialement accusé que d’avoir été trop grand, trop puissant, et d’avoir de ce fait séduit – au sens le plus littéral du terme – une frêle personne jusqu’à le mener à son lit.
La réponse a de quoi terrifier.
En le salissant et en l’avilissant. En allant fouiller et montrer des gestes sans rapport ni lien avec le viol dont il est accusé.
En construisant un continuum qui permettra de pouvoir dire : voilà un être à juger et condamner.
Lui plutôt qu’un geste qui lui, demeurera inexpliqué.
Comment le condamner d’avoir été ce que l’on a tant désiré et admiré, sans qu’à un quelconque moment, un geste, un mot, en cette affaire ait été déplacé ?
En le salissant, et en l’avilissant, par l’extérieur. En allant fouiller et montrer des gestes sans rapport ni lien avec le viol dont il est accusé.
En construisant un continuum qui permettra de pouvoir dire : voilà un être à juger et condamner.
Et c’est évidemment ce qui est arrivé, Mediapart en tête, toujours plus creusant, en ces affaires, dans l’indignité, allant en une autre affaire jusqu’à aligner les victimes comme du bétail, pour prouver.
Or tout cela ne permet en rien de prouver quoi que ce soit. Mais simplement d’encercler.
Voilà pourquoi le président de la République a parlé de chasse à l’homme. Car c’est littéralement cela, dont il est question. Car c’est littéralement à cela que la théorie du continuum cherche à nous vouer.
Car c’est la seule façon qu’a trouvé la justice, mais également la société, de gérer ces dossiers sans faits, tardant en conséquence des années pour se prononcer.
Chasser les hommes et les femmes, victimes comme accusés. Pour, par l’extérieur, trancher. Juger et condamner, absoudre ou dévaster.
Absolument. Entièrement. En contournant l’obstacle : celui du geste dont ils sont accusés.
Voilà naturellement pourquoi tant de personnes qui ont connu intimement M. Depardieu se sont levées pour le défendre, lui qu’elles ont connu comme il a été, y compris à l’égard de Mme. Arnould : en l’intime et non socialement, lorsqu’il désirait une femme, et non s’en amuser, prévenant jusqu’au bout, sans rien forcer.
Notons qu’aucune personne qu’il a intimement connue, c’est-à-dire avec laquelle il a eu un rapport sexuel ne l’accuse d’avoir débordé au cours de celui-ci ou dans l’immédiate précédence, alors que des dizaines l’accusent, par l’extérieur, de comportements déplacés.
S’en déduit que M. Depardieu aurait de lui-même brisé ce faux continuum que l’on ne cesse de tenter de créer, en distinguant de lui-même le comportement machiste, dégueulasse, insupportable mis en œuvre dans l’espace social, de celui qui aurait cours dans l’espace du rapport intime, de la séduction, du lien amoureux et sexuel, qui s’en serait trouvé préservé.
Cela doit-il valoir certificat d’impunité ? Non, et c’est bien pour cela que la société s’en est saisie.
Pour condamner ce qui la concerne, et ne concerne pas l’État. Celle du gros dégueulasse qui laisse traîner ses pattes et, de commentaire graveleux en dégradation psychologique, participe, dans l’espace public et moral, d’un ordre patriarcal passé.
Cela en-fait-il un violeur, dans l’espace privé ? Non. Et rien ne permet de l’affirmer.
Car l’ordre social n’est pas l’ordre de l’intime. Et parfois, il en est même l’opposé.
On ne condamne pas un homme, mais un geste, lorsque l’on décide d’ester en justice.
Voilà ce que nous tous, à commencer par nos magistrats, semblons avoir oublié. Voilà ce que ses plus proches ont semble-t-il tenté de rappeler.
Cela pose la question de la définition actuelle des infractions judiciaires, et des limites du système dont on a hérité. Cela pose la nécessité de créer une infraction d’abus sexuel, distincte de l’agression sexuelle et du viol, qui comportent, étymologiquement, la notion de violence, laissant une trace sur un corps, et non sur une âme, et qui sont sans rapport avec la société.
Voilà donc une infraction qu’il nous faudrait créer, si l’on cherchait à mêler espace social et ordre étatique.
S’imposer à un autre être qui a résisté. Voilà ce que doit, devrait être et demeurer qualifié de viol, sauf circonstances exceptionnelles (abolition volontaire du discernement du tiers par l’administration de substances toxiques ; capacité objective de contrainte sur l’autre, par exemple dans un cadre d’ascendance familiale doublée de minorité, etc).
Tout le reste est dérive et tentative de justification d’une dérive insensée, qui dans l’absence de geste et d’élément objectif, abattra nécessairement les êtres, sans ne jamais approcher une quelconque vérité.
Et dès lors, à tous les arbitraires menace de nous exposer, ainsi qu’à toutes les tentations et tous les excès.
À commencer par ceux de la rumeur publique, du portrait impressionniste qui, par incompréhensions successives, haine ou phobie de l’étrangeté, obsession de la normativité, condamnera celui qui n’a rien fait.
Dérive insensée, car elle crée un jeu, une incertitude dans le rapport à l’autre qui atteint au plus précieux de toute société, la capacité à se lier. À explorer et se différencier. À exister en tant qu’individualité.
Dérive insensée, parce qu’elle permet à l’État de s’immiscer là où on l’a toujours tenu écarté.
Dérive insensée enfin, parce que, loin de nous protéger, elle ouvre la porte à ce que des magistrats se voulant ou croyant omniscients, se saisissent de ce qu’ils ne peuvent déterminer, pour juger et condamner, sur le fondement de ouï-dires que rien ne pourra jamais prouver.
Cette dérive offre un pouvoir démesuré à trop de personnes – policiers, magistrats, particuliers… société – qui, pour une infinité de raison, seront exposés à la tentation d’utiliser cette extension paradoxale du domaine du viol, non pour aider les victimes, mais solder leurs comptes, profiter d’un sentiment de toute puissance, projeter leurs névroses ou simplement errer, exposant les véritables victimes à la décrédibilisation de leur parole et à une réaction toujours plus inquiète et rétive du reste de la société.
Il existe un risque sérieux de ce que la justice, se croyant consacrée par ce mouvement, devienne le vulgaire instrument de la petitesse humaine, instrument de la certitude, la vengeance, la projection, le mimétisme ou l’obsession, dont le droit est censé nous protéger.
Le bon sens et l’inquiétude des magistrats, tout autant que leur lâcheté, explique probablement que d’une façon ou d’une autre, ils aient cherché à tant faire durer, comme inquiets d’eux-mêmes et de ce qui leur est demandé, la procédure dont il est ici objet.
Cela doit à la fois nous rassurer, et nous inquiéter
Cinq ans et demi après les faits, M. Depardieu n’a pas été jugé, a fortiori condamné. Et la justice est paralysée.
Parce qu’il n’y a pas de geste. Et qu’on ne leur a proposé, en toutes ces années, que des êtres à juger.
Ces magistrats, qui savent que l’institution judiciaire ne sait que faire des êtres, et n’a été instituée que pour juger de faits, n’ont eu ni le courage de se trahir, ni de renoncer à juger. Alors, s’il fallait le leur rappeler : la justice n’a, n’aura jamais, et ne devrait jamais avoir la possibilité de sonder les âmes.
Elle ne l’a eu qu’une fois. Au cours de l’inquisition, qui se croyait omnisciente et divinement ordonnée.
Délestés de l’idée qu’un Dieu qui les hommes en robe ordonnerait et inspirerait, il nous appartient de tout faire pour, nous tenant de ces fantasmes écarts, nous rappeler à notre condition humaine, strictement humaine, et nous interdire tout débordement, toute pénétration indue d’espaces réservés.
Faute de quoi c’est aux portes de l’enfer que nous finirons par toquer.
DESCRIPTION DES FAITS PAR LES ENQUÊTEURS SUIVANT LA VIDEOSURVEILLANCE
09H21 : « Gérard Depardieu lui prend la main et la tire vers lui. Elle se lève et se met debout face à lui, ses mains toujours derrière son dos. Gérard Depardieu glisse ses mains sous et dans le short de Charlotte. Il semble se lécher les doigts. Tous les deux discutent.
09H26 : « Gérard Depardieu attire vers lui le visage de Charlotte Arnould. Il s’ensuit un baiser long. Charlotte a toujours les mains dans le dos. Puis tous les deux discutent. Gérard Depardieu glisse à nouveau ses mains sous le Tshirt large de Charlotte. Lui touchant la poitrine, puis à nouveau l’entrejambe.
10H : Gérard Depardieu fait un signe de tête pour désigner l’étage. Elle acquiesce de la tête puis elle pointe du doigt l’escalier ou l’étage pour, semble-t-il, demander confirmation. Il se lève de sa chaise. Charlotte semble toujours calme. Elle le suit. Tous deux montent à l’étage en empruntant le grand escalier.
10H22 : Sortie de Charlotte Arnould, laquelle traverse la cour d’une démarche normale, aux pas assurés.